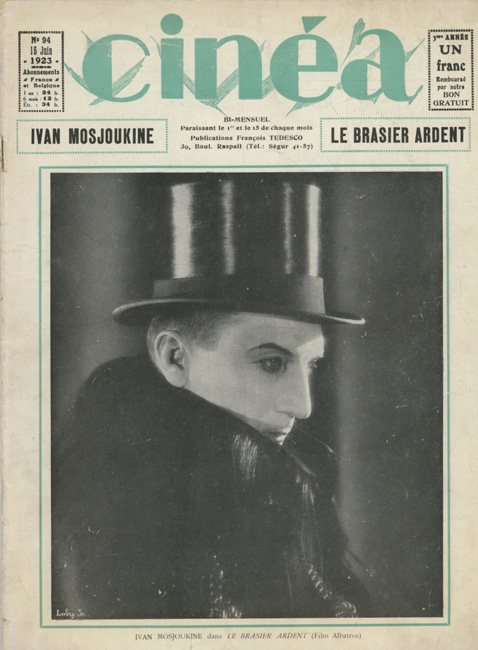Paris, décembre 1923
Où vient de présenter Hamlet (1er décembre 1923, à 10 heures Ciné Max-Linder) non selon la tradition shakespearienne, mais d’après la légende historique telle que la conta, il y a des siècles, l’historien danois Saxo Grammatiens (1).
C’est à lui que l’a empruntée le célèbre conteur Belleforest en publiant sa collection de Nouvelles en sept volumes, qui parut en 1564.
De cette collection fut traduite en anglais l’histoire d’Hamlet, dont s’est inspiré Shakespeare.
Dans la littérature du monde, il ne peut probablement pas être trouvé un caractère plus fascinant et plus attachant qu’Hamlet, le chef-d’œuvre de Shakespeare.
Ce caractère remarquable exerce une attraction sur les jeunes gens et sur tout le monde; attraction profonde en raison de l’incompréhensible nature de l’homme.
Un terrible mystère plane sur Hamlet.
Personne n’a encore été capable d’expliquer quels motifs et quelles émotions conduisaient ce mélange humain et étrange de passion et d’indifférence, de colère et d’irrésolution.
Est-ce qu’Hamlet était fou, comme on l’a dit?
Etait-ce un esprit concentré, cachant derrière une apparente folie une volonté profonde et violente de venger le meurtre de son père?
Etait-il si fatigué de la vie que ses paroles bizarres et étranges comme ses actions, ne montraient que mépris pour l’opinion des autres?
Depuis des siècles, les savants ne sont jamais tombés d’accord sur Hamlet et le sens de cette légende.
Même les plus grands poètes ont discuté la vie d’Hamlet.
Voltaire considère les pièces de Shakespeare comme un mélange maladroit de caprices et de non-sens.
Herder, le philosophe réputé, tient la manière d’Hamlet pour de l’affectation.
Même Gœthe a impitoyablement rejeté la valeur aujourd’hui incontestée du drame d’Hamlet.
Le professeur Edward P. Vining, savant américain qui a étudié Shakespeare, a donné une théorie originale de la faiblesse sauvage d’Hamlet. Dans son ouvrage érudit Le Mystère d’Hamlet, il émet l’hypothèse. qu’Hamlet était une femme. Et le docteur Vining appuie largement sa thèse sur les propres écrits de Shakespeare.
Cette explication audacieuse du caractère d’Hamlet est, en partie, la base du film présenté. La situation est extraordinaire: Une princesse forcée pour raison d’Etat à prendre l’aspect d’un prince, est soudainement mise en face d’événements que, seul, un homme de forte volonté et plein de confiance en lui pourrait surmonter.
Nous sommes ainsi reportés à l’ancienne légende d’Hamlet où Shakespeare puise la première conception de son immortelle tragédie.
Il est certain aussi que Shakespeare trouva nécessaire de changer quelques-uns des épisodes de l’ancienne histoire pour l’adapter au théâtre.
Dans cette version, nous avons suivi de plus près la version originale, et le malheureux prince est montré sous un jour nouveau et intéressant, souvent identique à la version shakespearienne et souvent différent.
Le prince danois, incarné d’une manière réaliste par Asta Nielsen, émeut d’une rare manière le cœur humain.
Sa manière d’interpréter le rôle le rend toujours tragique et donne l’impression profonde des douleurs et des souffrances que peut subir une âme noble.
Asta Nielsen est entourée d’un admirable groupe d’artistes, formant un ensemble qui, au point de vue de la perfection, a rarement été aussi bien atteint au cinéma.
En quelques lignes, résumons le sujet de ce beau drame tel qu’il a été réalisé cinématographiquement d’après la légende historique de Saxo Grammatiens.
On verra combien il diffère du drame si remarquablement interprété jadis à la Comédie-Française par Mounet-Sully ; si prodigieusement chanté, à l’Opéra, par Faure.
Au cours de la bataille engagée entre les armées danoise et suédoise, le roi de Suède fut tué, et son adversaire, le père d’Hamlet, grièvement blessé.
C’est durant cette campagne que la reine Gertrude de Danemark mit au monde une princesse.
Croyant la blessure du roi mortelle, afin de garder la couronne, la reine fit annoncer au peuple la naissance d’un prince.
En l’absence du roi, la reine Gertrude s’était laissé courtiser par son beau-frère Claudius. Les deux amants résolurent de se débarrasser du roi, et chargèrent de l’exécution du crime le lord chambellan Polonius.
Afin que le prince Hamlet ne put être un obstacle à leurs coupables desseins, il fut envoyé à l’Université de Wittemberg.
Le prince Hamlet apprit par des serviteurs que son père avait été emprisonné sur l’ordre de son oncle Claudius qui s’était emparé de la couronne et avait épousé sa mère.
Ayant la certitude que ce dernier était le coupable, le prince simula la folie pour mieux surveiller ses faits et gestes.
Il engagea une troupe de comédiens et leur fit jouer devant la Cour une scène reconstituant le meurtre de son père.
Le trouble que le roi et la reine exprimèrent durant la représentation, confirma Hamlet dans son opinion; il résolut de tuer le roi son oncle. Mais ce dernier lui fit quitter le château et l’envoya, accompagné de deux serviteurs, au roi Fortinbras dans l’espoir de le faire emprisonner.
Contrairement aux prévisions de Claudius, le roi Fortinbras traita Hamlet en souverain et lui offrit son armée pour arracher le Danemark des mains de l’usurpateur.
L’armée suédoise se mit en route, guidée par Hamlet, et campa aux abords d’Elseneur.
Pendant la nuit, Hamlet se rendit au Palais et trouva le roi Claudius et ses courtisans se livrant à des orgies dans une tour du château. Profitant de l’ivresse générale, il mit le feu à la tour dans laquelle Claudius périt.
La reine, craignant la colère de son fils, résolut sa mort.
Elle le fit provoquer en duel-par Laertes, le frère d’Ophélie qui meurt de chagrin de se voir délaissée par Hamlet.
Le duel eut lieu avec des épées empoisonnées. Hamlet fut blessé mortellement devant la reine qui, ayant par mégarde absorbé un poison, s’écroula sur le trône.
A ce moment arriva, mais trop tard, le roi Fortinbras, qui fit rendre les honneurs funèbres au malheureux prince Hamlet.
Asta Nielsén, l’incomparable artiste danoise, s’est surpassée dans ce rôle magnifque. Elle est l’inoubliable interprète du film, dont le jeu, unique en son genre, s’adapte admirablement aux lois optiques de l’art cinématographique.
Tous les autres rôles tenus à côté d’elle sont interprétés avec talent et la mise en scène se fait remarquer par la richesse, la somptuosité de ses reconstitutions d’une époque si lointaine qu’elle semble faire plus partie de la légende que de l’histoire.
Pour nous résumer, c’est un très beau film, qui aura un gros succès.
V. Guillaume-Danvers
- Saxo Grammaticus